De l'autofiction comme quête (Claire Fercak)
Par Arnaud Genon le lundi, novembre 8 2010, 21:06 - sur textes littéraires - Lien permanent
Claire Fercak, Rideau de verre
Gallimard 2007, rééd. J’ai lu 2010. 4 € 80
ISBN : 978-2-290-01414-1
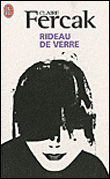
Comment dire une identité meurtrie ? Comment s'écrire quand le « je » fragmenté ne se perçoit que comme pris dans le prisme d'un kaléidoscope, lorsque « l’ego s’est désintégré », « a explosé » ? L'autobiographie classique, rousseauiste, qui traque le moi dans sa permanence, dans son unité, se trouve être bien impuissante dans le cadre d’une telle entreprise. C’est le constat que semble avoir fait Claire Fercak en écrivant son premier roman, Rideau de verre, initialement publié en 2007 et que rééditent les éditions J’ai lu. Alors, il s'est agi pour la jeune auteure de chercher ailleurs, d'expérimenter de nouvelles formes, de nouvelles postures narratives pour traduire ce qui se joue en elle, pour reconstruire ce que la vie tente, a tenté de mettre à mal.
La première de ses expérimentations, à l’instar de Serge Doubrovsky ou de Chloé Delaume, consiste à inventer sa propre langue, celle, unique, apte à traduire le monde intérieur, à le révéler, en désordre, tel qu’il arrive, qu’il surgit : « Elle ne sait pas trop comment s’y prendre, de quel côté crier, sur quel ton, dans quelle langue. (…) Elle cherche une écriture. Elle court après l’idiome de la première enfance. Celui que la douleur a façonné, puis tétanisé parce qu’elle l’affronte sur son propre terrain ».
En ce qui concerne la posture énonciative, la narratrice alterne entre la première et la troisième personne, comme pour donner corps à la voix (« les mots sont de la chair, la mienne est douloureuse ») ou prendre la distance nécessaire, provoquer ce qui relève d’une autoscopie permettant d’affronter l’angoisse du souvenir. « Captive d’un corps souffrant », trouvant « légèrement déprimant d’être enfermée dans son ego, sa mémoire et sa peau », la narratrice cherche alors par ce procédé narratif à en sortir, par là, à s’en sortir.
L’histoire, celle d’une enfant maltraitée, par la vie (atteinte d’une maladie génétique), par le père aussi (« au moins si je mourais, définitivement le cauchemar du père serait terminé »), est l’occasion de questionner la mémoire, le passé, les mots pour le dire. Ce à quoi la narratrice accède par ce travail n’est jamais ce qui était visé. Mais il faut « Accepter. Que le passé ressassé n’est pas composé d’événements précis mais morcelés, douteux. Parfois imaginés ». Ce qui est pris, disait Leiris, est toujours l’ombre et non la proie.
Cette autofiction expérimentale est aussi un moyen, tout simplement, de « consentir à la douleur » et de faire de ce consentement, de cet acte de résilience, devenu littérature, une manière de combler les brèches… Et de continuer.
Arnaud Genon