L’insoutenable lourdeur du non-être (Arnaud Genon)
Par Arnaud Genon le jeudi, juin 30 2016, 22:14 - sur textes littéraires - Lien permanent
Tu vivras toujours : l’insoutenable lourdeur du non-être
Arnaud Genon, Tu vivras toujours, Rémanence, Traces, 2016
Par Alexandre Dufrenoy
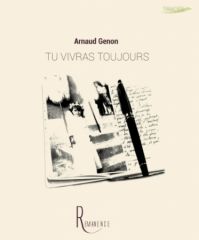
« Le tombeau des morts est le cœur des vivants » (p. 76). Cette phrase de conclusion, librement empruntée à l’historien romain Tacite, pourrait, à elle seule et sous forme de maxime, suffire à résumer le projet scriptural qui anime ce bref récit de moins de 100 pages. Après avoir, de par sa profession d’enseignant-chercheur, beaucoup lu, beaucoup écrit sur la littérature en commentant ce que faisaient les autres – on lui doit ainsi de nombreux travaux critiques autour de l’œuvre d’Hervé Guibert, écrivain-météore dont il s’est fait une spécialité et auquel il a consacré un mémoire de maîtrise et une thèse de doctorat –, Arnaud Genon change de costume. À l’aube de la quarantaine, il ose s’aventurer de l’autre côté du miroir et prendre à son tour la plume pour accoucher de ce très beau premier livre qu’est Tu vivras toujours. On se trouve là face à un texte simple, intense, profond et émouvant, qui tend vers l’universel et qui séduit d’emblée par ses indéniables qualités stylistiques. Même si, à première vue, le sujet traité n’a rien de fondamentalement nouveau, force est de reconnaître que ce « roman » – c’en est un, on l’apprend à deux reprises dès le paratexte, sur la quatrième de couverture et la page de titre – vient alimenter une tradition narrative bien française : il pourrait sans problème trouver place parmi ces figurations du deuil, ces mausolées de papier qui, à l’image du Livre de ma mère (1), d’Une mort très douce (2), d’Une femme (3), de Lambeaux (4) ou encore, plus récemment, de Rien ne s’oppose à la nuit (5), s’attachent à célébrer une présence maternelle trop tôt envolée.
La sienne, l’auteur l’a perdue adolescent. Il avait treize ans. Elle, elle en avait trente-neuf lorsqu’elle fut, « le mercredi 18 janvier 1989 » (p. 7), terrassée par un cancer du sein. Ce jour-là, la vie du jeune garçon qu’il était a définitivement basculé. Son monde a tremblé, vrillé, et ses illusions se sont à jamais effacées. Aujourd’hui adulte et père de famille, profitant de l’écart temporel qui, dans ce genre de récits, distingue toujours l’énoncé de l’énonciation, Arnaud Genon tente d’expliquer a posteriori son ressenti de fils devenu orphelin. Il l’exprime en ces termes : « Je n’étais pas celui que je suis maintenant. Je ne serai plus jamais celui que je fus alors. Il y a comme une fissure qui nous sépare. Une fracture. Maman, en me laissant, m’a scindé en deux » (p. 21). Or c’est précisément de cette faille existentielle, de cette béance ouverte en lui par la perte prématurée (métaphorisée dès la p. 9 par la description d’une mauvaise jointure entre deux bandes d’un papier peint bleu nuit ; ici l’indication du coloris est d’autant plus symbolique qu’elle permet à l’écrivain, par le biais d’une prolepse, d’annoncer une autre nuit : celle du sommeil éternel) que jaillira l’envie, le besoin de raconter ce funeste événement.
D’où une écriture nécessairement cathartique, sous-tendue par ce que l’on pourrait nommer une « tentative de restitution », selon la formule qu’utilisait Claude Simon dans le sous-titre du Vent (Éditions de Minuit, 1957). Pour être tout à fait comprise dans le contexte qui nous occupe, cette expression devrait s’envisager sous deux angles : non seulement comme une reconstruction narrative – Arnaud Genon y a en effet « reconfiguré » (p. 31) à l’écrit les souvenirs réels d’un trauma, paradoxalement « conservés dans leur virginité, en dehors de toute fiction » (p. 21) et, dans le même temps, « fragment(és) en images, anecdotes, phrases, mots » (p. 69), comme des madeleines de Proust émiettées –, mais aussi comme quelque chose à « rendre », comme lorsque l’on restitue un objet à quelqu’un. Mais que s’agit-il de rendre, au juste ? Rien de matériel. Ce serait plutôt une réalité abstraite, voire philosophique, qui s’apparenterait à une reconnaissance de dette, un remerciement différé pour cette vie commune, cet amour inconditionnel qui unit réciproquement une mère et son enfant. Il s’agit, par l’encre déversée, de garder la trace de l’être cher, qui revit grâce à la narration. « Traces ». Comme le nom de la collection qui accueille Tu vivras toujours.
« On ne résigne jamais à la mort des autres, de ceux que l’on aime », nous dit l’auteur sur un ton empreint de mélancolie. « C’est pour cela, continue-t-il, que l’on s’invente des vies après la vie, pour les sauver de la mort. Pour qu’elle n’ait pas le dernier mot » (p. 12).
Personne n’est dupe. Tout le monde sait qu’il faut avoir eu l’expérience de la vraie vie pour écrire une chose pareille. Un recul nécessaire. Une sagesse particulière. Une certaine maturité, aussi. Comme lecteur, on comprend assez vite qu’un incipit tel que « Je sais précisément quand maman est morte » (p. 7) – qui n’est pas sans rappeler celui de L’Étranger de Camus – ne peut avoir été écrit que par Arnaud Genon, l’adulte qui, dans le présent de son écriture, en 2016, vingt-sept ans après le drame, fait retour sur « un autre âge », « celui d’avant (l)a disparition » (p. 21). Car comment, aussi jeune, un enfant pourrait-il savoir « précisément » ce qu’est la mort, la finitude des êtres ? Comment pourrait-il même imaginer que la vie ait des limites ? « On ne croit pas en la mort, à treize ans » (p. 73), et on y croit sans doute encore moins quand elle est causée par un fléau aussi grave, aussi long que le cancer. À cet âge-là, qui est par excellence « le temps de l’innocence » (p. 65), la douleur, la maladie, on en a pas réellement conscience. Examens médicaux, hôpital, opérations, chimiothérapies, chute des cheveux, cellules attaquées, rayons, rémission, rechute... Tous ces mots de scientifiques font peur. Ils nourrissent l’angoisse et constituent « le champ lexical d’une poésie douloureuse » (p. 58).
On sent, instinctivement, qu’il est en train de se passer quelque chose d’anormal. Mais on ne mesure pas la gravité, ni les enjeux. On ne comprend pas. On se dit, contre l’effroyable évidence, que ça passera vite. On espère les jours meilleurs. On tente tant bien que mal de vivre sa vie d’enfant, à l’écart des grandes personnes, en sachant bien, intérieurement, qu’on nous masque volontairement une partie du réel.
Dès lors, pour pallier ces manques imposés, on trouve refuge dans l’imaginaire, comme pour fuir de trop lourdes réalités. Un bovarysme consenti, un cocon protecteur. Comme si la fiction pouvait aider à adoucir la lourdeur de l’absence, à tenir la mort à distance. C’est exactement ce qu’il se passe dans ce petit livre puisqu’Arnaud Genon, en fin connaisseur de la forme autofictionnelle, situe tout de suite, dès la quatrième de couverture, son entreprise littéraire dans le sillage de Serge Doubrovsky. En d’autres termes, on l’a vu plus haut, il fait de son texte un « roman » vrai. Dans cette perspective, il (se) forge « un autre moi » (p. 21), un avatar fictif qu’il prénomme « Arnaud » – son identité est explicitée par deux fois (p. 10, 72) au détour de dialogues – et à qui il fait prendre en charge la narration des trois ans qui précèdent le mort de sa maman, depuis le diagnostic du cancer jusqu’au décès proprement dit. Trois ans, c’est si court à l’échelle d’une existence, mais interminable si l’on se place du point de vue de l’enfant…
Avant de conclure, il est un dernier aspect de Tu vivras toujours que l’on ne peut pas ne pas aborder : sa dimension métapoétique. En effet, au cours d’une des rares scènes réellement heureuses que contient le roman, l’auteur, dans une remarquable mise en abyme, se met lui-même en scène en compositeur autofictif. Il se revoit enfant de onze ans lorsque, pour les besoins d’un devoir d’école imposé par l’instituteur qu’il abhorre, il doit relater un souvenir positif : incapable d’en trouver un qui vaille la peine, il prétexte alors des retrouvailles familiales festives autour d’un barbecue, l’été, au cours de vacances passées dans les Landes : « Je pris beaucoup de plaisir à l’écriture de ce mensonge. Ce n’était pas une fiction, juste un arrangement avec la réalité. J’avais distendu le temps et l’atmosphère, ajouté quelques éclats de rire, intercalé des souvenirs beaucoup plus anciens, changé le menu… Chaque élément du récit, pris séparément, était vrai, finalement. Ils avaient existé. Mais dans deux lieux et à des dates différentes. J’avais simplement reconfiguré l’ensemble » (p. 31).
Cette superbe définition de l’autofiction pourrait aussi, par extension, boucler la boucle et valoir de description programmatique pour l’ensemble de ce fin récit poignant, sans pathos, oscillant continuellement entre tristesse et espérance, individualité et universalité. De ceux qui, une fois lus, continuent de nous émouvoir longtemps encore. Arnaud Genon s’y livre, s’y délivre en toute liberté, avec respect et pudeur, à travers un requiem qu’il offre à cette mère passionnément aimée. Tu vivras toujours, c’est aussi une leçon de vie, une puissante réflexion sur le deuil, la perte, la résilience, l’écriture et l’amour. Et les lecteurs, eux, en ressortent à jamais grandis.
Notes
(1). Albert Cohen, Le Livre de ma mère (1954), Paris, Gallimard, « Folio », 1974.
(2). Simone de Beauvoir, Une mort très douce (1964), Paris, Gallimard, « Folio », 1972.
(3). Annie Ernaux, Une femme (1988), Paris, Gallimard, « Folio », 1990.
(4). Charles Juliet, Lambeaux (1995), Paris, Gallimard, « Folio », 1997.
(5). Delphine de Vigan, Rien ne s’oppose à la nuit (2011), Paris, Le Livre de Poche, 2013.
Lien vers le site de l'éditeur : http://www.editionsdelaremanence.fr/produit/tu-vivras-toujours/
Alexandre Dufrenoy, le 30 juin 2016